
Elle fait glisser ses doigts le long des cordes effilochées. Ce contact râpeux lui rappelle ses paumes rougies de les avoir trop serrées, à l’âge où elle essayait de toucher le ciel. La balançoire vieillit mal. Son grincement s’est mû en supplique, le bois sous ses fesses est vermoulu. Sa jumelle n’a pas meilleure mine. La mairie va sans doute les remplacer, ou au moins les enlever.
Elle se demande combien d’heures elle a passé à viser les nuages, vissée à son siège de bois. Elle était prête à prendre le risque de faire un tour complet du portique, persuadée que ce risque existait vraiment. À ces heures enfantines s’en sont ajoutées d’autres, des heures de balançoires qui ne se balancent pas.
Tacitement, inconsciemment même, c’était toujours le lieu choisi pour les confidences adolescentes, alors même que les bancs étaient nombreux autour du lac, et l’été l’herbe était même plus confortable. Mais c’était là, les fesses sur le bois, les mains accrochées aux cordes comme si c’était nécessaire, les yeux dans les yeux et la voix baissée, qu’il y ait des cohortes d’adolescents venus se prélasser au soleil ou pas le moindre chat à l’horizon. Les balançoires étaient témoin de tous les secrets.
Y compris celui de trop.

Les yeux de Sophie étaient comme éteints ce jour-là, eux dont la lumière avait coutume d’illuminer les après-midis de leur enfance. Leur amitié était née de là, précisément sur cette balançoire. Toutes deux faisaient la course, voulant atteindre les nuages la première. Puis, ce furent des jeux, des rires, des promesses, des jours entiers à s’apprivoiser l’une l’autre. Et, sans s’en rendre compte, elles étaient devenues meilleures amies. Le temps, jusqu’alors, n’avait jamais pu émousser leur lien.
Mais depuis quelques semaines, Sophie avait la mine basse, le sourire en berne. Personne ne savait pourquoi, pas même sa meilleure amie. Celle-ci essayait par tous les moyens de ranimer le feu de la joie qui semblait avoir quitter Sophie. Elle l’avait invitée plusieurs fois chez elle, avait improvisé des sorties en ville, dans les boutiques, au cinéma, pour lui changer les idées. Rien n’y fit. Comment soigner un mal dont on ignore l’origine ?
Un jour, elle l’avait emmenée au parc, et elles s’étaient assises comme à leur habitude sur cette bonne vieille balançoire. Ce lieu de toutes les confidences était l’endroit parfait pour lui tirer les vers du nez. Finalement, c’est Sophie qui parla la première.
Elle fixait le sol. La pointe de ses chaussures grattaient la terre qui n’était plus qu’une plaie noire. Les mots finirent par s’échapper de sa bouche. Sa voix était comme rouillée. Et parmi ces paroles accidentées, un mot se détacha des autres, un mot qui écrasait tous les autres de son poids, un mot point final. Le monde venait de se retourner. Leucémie.
Sophie vit son amie se décomposer. Celle-ci ne comprenait pas, refusait de comprendre. C’était l’absurdité même. Un gouffre d’une profondeur insondable s’était creusé sous ses pieds. Comment vivre après avoir appris cela ? Sophie, sa meilleure amie, allait mourir, et elle ne pouvait rien faire contre ça.
Une ombre vint s’asseoir sur les balançoires, auprès des deux jeunes filles.
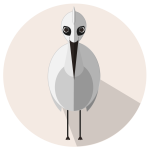
Elle avait tourné sans réfléchir.
Sur le chemin en revenant de la maison de retraite, où sa grand-mère l’avait accueillie avec un sourire triste, elle avait vu l’embranchement, la patte d’oie comme ils disaient, et sans y penser, les gestes s’étaient enchaînés, le clignotant – alors qu’il n’y avait personne sur cette route de campagne –, un tour de volant, le chemin sinueux qu’elle avait tant de fois emprunté à vélo, et tout au bout, le lac. Paisible et immuable.
Le frein à main, ses bottines de ville dans la terre glaise, l’herbe haute. Des années qu’elle n’était pas venue là. De la balançoire ne restait que le portique, dévoré par la mousse.
Après l’enterrement, elle se l’était promis : « Sans toi, je n’irai plus ». Elle avait parlé de la balançoire dans son discours à l’église – façon pudique de ne pas parler du vide qui avait creusé sa poitrine, depuis ce jour où. Depuis que. Depuis ce mot en trois syllabes, leu-cé-mie. Trois syllabes pour un vertige immense.
Elle s’approche du portique esseulé, mue par une impulsion qu’elle ne s’explique pas, pourquoi là, pourquoi maintenant ? L’herbe trempe ses collants, l’air frais lui mord les joues. Elle n’est plus qu’à un pas, son bras se tend, sa main touche le bois, ou plutôt se laisse toucher par lui. Une émotion intense la saisit. Par réflexe, son autre main se pose sur son ventre. Connexion entre l’écorce et la chair. Elle pourrait presque percevoir le pouls du tronc. Entendre le grincement des boulons. Sentir le déplacement de l’air. Sophie n’est pas là, mais Sophie est partout. Et cette promesse, qui prend tout son sens à présent : « Je n’irai plus sans toi, car en réalité, tu y seras déjà. »
J’existe.



0 commentaires